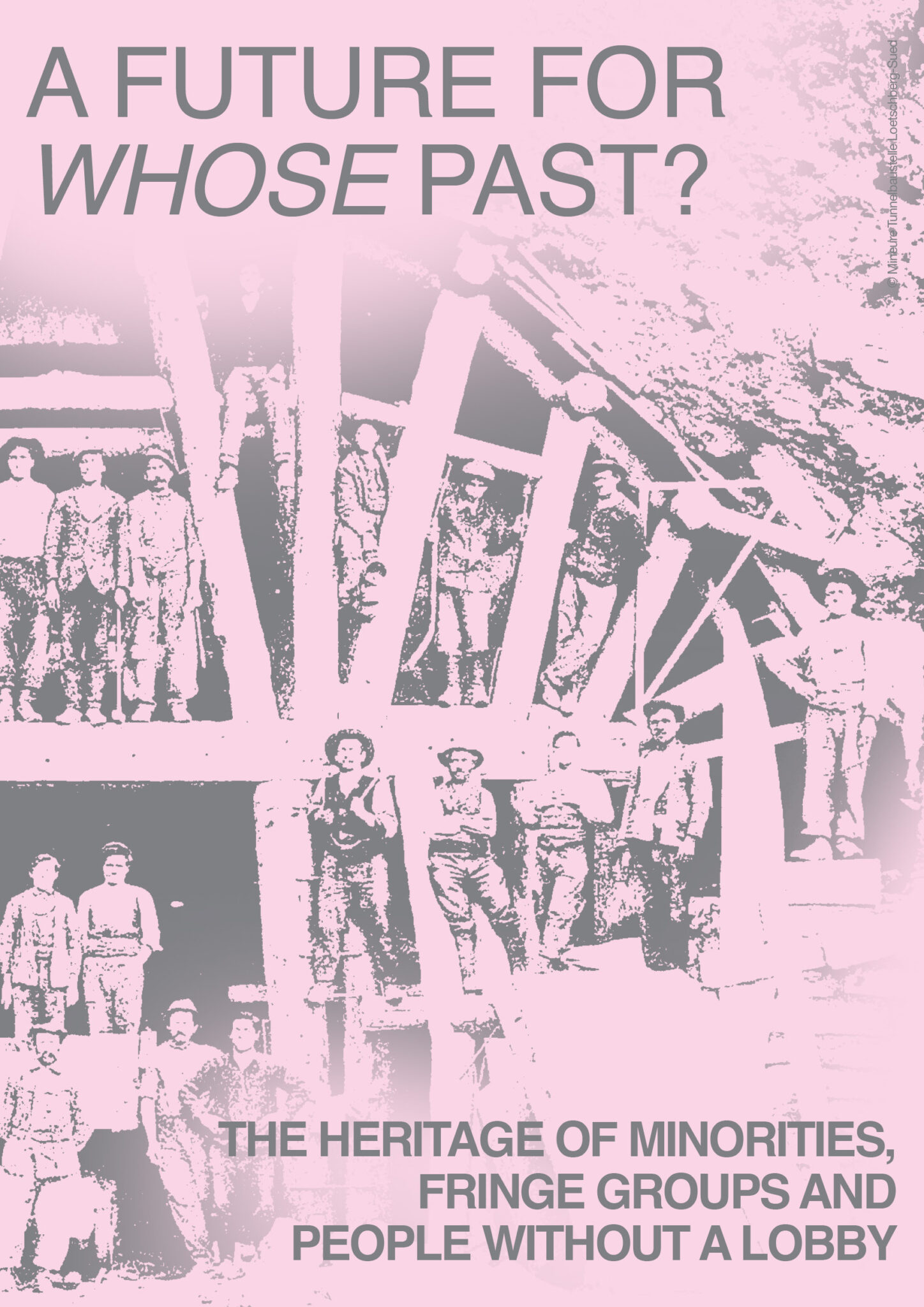Un laboratoire de minorités - Le territoire tessinois constitue en lui-même une forme de minorité culturelle et linguistique au sein de la Confédération suisse: seul canton officiellement monolingue italophone, il incarne une condition de marge au centre, où la culture dominante se construit souvent en dialogue -ou en tension- avec les pôles germanophones et francophones.
Ce statut périphérique, loin de réduire la complexité de son tissu social et patrimonial, en révèle au contraire la richesse. Le territoire sud-alpin est habité, traversé ou façonné par une multiplicité de minorités, souvent invisibles dans les discours institutionnels sur le patrimoine. Reconnaître ces minorités, c’est non seulement partie intégrante de la définition du patrimoine, mais aussi remettre en question les hiérarchies implicites qui déterminent ce qui mérite mémoire, protection ou transmission.
C’est dans cette diversité que le patrimoine culturel immatériel trouve aujourd’hui l’une de ses plus grandes légitimités : non comme simple complément à l’héritage monumental, mais comme dispositif de rééquilibrage mémoriel. Le Tessin, historiquement marqué par les migrations, les échanges transfrontaliers et l’expérimentation culturelle - particulièrement significative dans le contexte du Monte Verità - constitue ainsi un terrain fertile pour reconsidérer les politiques patrimoniales à partir des marges.
Au fil des années, l’Ufficio dell’analisi e del patrimonio culturale digitale (UAPCD) a accumulé une diversité d’expériences qui touchent à des dimensions multiples du patrimoine culturel. Qu’ils soient matériels ou immatériels, connus ou méconnus, ces patrimoines reflètent la complexité du territoire et portent les empreintes des majorités comme des minorités. Ils illustrent comment des formes patrimoniales peuvent contribuer à faire parler le passé et à construire une histoire plus inclusive.
Cette approche plurielle s’est structurée autour des deux services hébergés par l’office: l’Osservatorio culturale del Cantone Ticino (OC) et le Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale (SVPC). Ces deux entités mobilisent des méthodologies distinctes mais complémentaires - quantitatives et qualitatives, synchroniques et diachroniques, analogiques et numériques - qui permettent d’explorer les dimensions dynamiques du patrimoine.
L’intervention de l’UAPCD s’articule autour de trois études de cas complémentaires, qui mettent en lumière les défis spécifiques rencontrés et les enseignements qui en ont été tirés.
Les patrimoines immatériels comme voix des territoires
Les récits, les traditions et les mémoires ne sont pas de simples témoignages historiques: ils agissent comme des médiateurs entre le passé et le présent. Des projets tels que la Guida letteraria della Svizzera italiana (http://guidaletteraria.ti.ch) montrent comment ces patrimoines peuvent relier les lieux à des récits oubliés, transformant des espaces ordinaires en lieux porteurs de mémoire et d'identité.
Nombre d’auteurs notables ont vécu ou séjourné dans cette région, faisant du territoire un arrière-plan narratif et représentant la Suisse italienne non comme un espace monolithique, mais comme un lieu d’accueil, de refuge et d’inspiration créative.
Ce projet articule diffusion et médiation du patrimoine littéraire avec une forte dimension participative. Lancée en 2019 par l’OC, l’initiative a permis de collecter à ce jour 3'044 citations géoréférencées, 852 auteurs et 366 lieux, grâce aux contributions du public. Le projet se déploie actuellement sous forme de carte partagée associant citations et lieux, avec des données entièrement accessibles via un service de cartographie en ligne (WMS). Il a également soutenu la création de nombreuses initiatives parallèles: des activités pédagogiques dans les écoles obligatoires, des collaborations avec des cours universitaires, des publications ainsi que la réalisation d’une exposition itinérante.
Cette approche collaborative favorise l’engagement des communautés locales et renforce le sentiment d’appropriation du patrimoine immatériel, tout en mettant en lumière les connexions internationales de la région. Sur cette base, il est possible de développer des itinéraires de découverte thématiques, comme une carte littéraire centrée sur les minorités culturelles ou sociales. Dans cette perspective, le projet transfrontalier Libervie LIBERVIE - LIBERtà di muoversi: VIE Culturali e Letterarie Transfrontaliere Accessibili e Inclusive (Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021/2027) constitue une piste particulièrement prometteuse.
La carte crée le territoire, et le territoire crée la carte : aucune de ces affirmations n’est vraie isolément, mais leur tension réciproque révèle une vérité partagée. Le lien entre texte et lieu n’est ni unidirectionnel, ni mécanique, mais relève d’une relation interconnectée et dialogique, qui renouvelle notre médiation avec le territoire. La littérature apparaît ainsi comme un outil puissant de sensibilisation aux enjeux des minorités, capable d’offrir une compréhension plus nuancée de leurs expériences et de leurs luttes.
Faire parler le passé dans une perspective inclusive
En l’absence de reconnaissance institutionnelle, de nombreux patrimoines restent invisibles. Des initiatives telles que Sàmara (http://samara.ti.ch) et l’Agenda culturelle de la Suisse italienne (http://www.ti.ch/agendaculturale), qui s’appuient sur des approches fondées sur les données ouvertes et les outils numériques, offrent des moyens concrets de documenter, diffuser et valoriser ces patrimoines souvent négligés. Elles posent également la question de la responsabilité des institutions publiques dans la constitution d’un environnement informationnel plus inclusif.
Le portail Sàmara répond à cette orientation en facilitant l’agrégation de contenus culturels catalogués provenant d’institutions publiques, académiques et privées. Ce service gratuit vise à mettre à disposition des chercheurs et du grand public une ressource centralisée pour l’exploration de collections patrimoniales - images, livres, objets, et autres types de documents. Le choix du nom et du symbole du projet s’inspire de la maison d’édition Larousse, avec sa devise "Je sème à tout vent". La sàmara - graine ailée de l’érable, commune dans la région - a été retenue comme métaphore d’un patrimoine en mouvement, à l’opposé des formulations institutionnelles rigides ou des acronymes autoréférentiels.
Le portail Agenda et Opérateurs culturels constitue quant à lui le point de repère des événements culturels organisés en Suisse italienne. Les données qu’il agrège sont librement accessibles (API) et peuvent être interrogées selon des filtres thématiques. Certains sont conçus pour répondre aux besoins de publics spécifiques, par exemple les événements en langues étrangères, ceux destinés aux jeunes ou à accessibilité différenciée. Depuis l’an dernier, la base de données est interconnectée avec les informations de Pro Infirmis, permettant de consulter des données détaillées sur l’accessibilité des lieux culturels recensés.
Le patrimoine numérique a acquis une importance croissante au cours des dernières décennies. Comme le souligne la Charte sur la préservation du patrimoine numérique, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO en 2003, il s’agit d’un enjeu collectif, à la fois technologique, culturel et institutionnel. L’accès au patrimoine culturel s’est indéniablement simplifié, favorisant des découvertes fortuites et des usages spontanés. Cependant, la croissance des données disponibles rend leur navigation complexe, notamment pour les utilisateurs non spécialisés. Pour répondre à cet enjeu, des vitrines thématiques sont des outils de plus en plus précieux afin d’offrir une entrée structurée et différenciée dans les contenus et d’accompagner les usagers dans leur exploration.
Impacts matériels et immatériels sur la Baukultur
Reconnaître et intégrer les patrimoines immatériels dans la planification territoriale ouvre la voie à des projets architecturaux et urbanistiques capables de refléter la diversité culturelle des sociétés. La mise en valeur de récits oubliés ou marginalisés inspire des interventions plus attentives à la mémoire des lieux et cohérentes avec une Baukultur durable, où l’héritage immatériel devient une composante structurelle de l’espace construit.
Cet impact, souvent sous-estimé, est pourtant reconnu dans la Stratégie Culture du bâti élaborée par l’Office fédéral de la culture (OFC): "La représentation du monde au moyen d’images dans l’ensemble identiques et abstraites modifie la perception de l’espace analogique et influe directement sur l’environnement physique. L’environnement social d’une personne n’est plus lié à un lieu physique déterminé et il existe une interaction constante entre l’espace numérique et l’espace analogique et bâti".
Cette réflexion met en évidence une transformation profonde du rapport au lieu. Le territoire ne se réduit pas à une entité géographique: il est façonné par une sédimentation culturelle, fruit de pratiques, de croyances et d’usages transmis au fil du temps. Les communautés produisent un espace vécu, traversé par des dynamiques symboliques et sociales souvent absentes des représentations traditionnelles.
Dans cette perspective, le patrimoine ne peut être envisagé comme une entité figée, mais comme un processus actif, à l’intersection de la mémoire, de l’espace et des pratiques sociales. Ce déplacement de regard permet de renouveler les politiques patrimoniales, en intégrant davantage de voix longtemps marginalisées.
En conclusion, sans la reconnaissance et la valorisation de ces patrimoines discrets mais fondamentaux, il devient difficile de faire véritablement parler le passé. Ils constituent un levier essentiel pour construire non seulement une mémoire partagée, mais aussi une politique patrimoniale réellement inclusive.
Roland Hochstrasser, 2025
Bibliographie
- Faro Convention. Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (2005). Council of Europe.
- Linee programmatiche cantonali di politica culturale 2024-2027 (2024). Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Repubblica e Cantone Ticino
- Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021–2024 (2019). Ufficio federale della cultura.
- Strategia Cultura della costruzione (2020). Ufficio federale della cultura UFC.
- Bauman, Z. (2011) Modernità liquida. Roma: Laterza.
- Fiorentino, Francesco, e Carla Solivetti. Letteratura e geografia: atlanti, modelli, letture. Macerata: Quodlibet, 2012